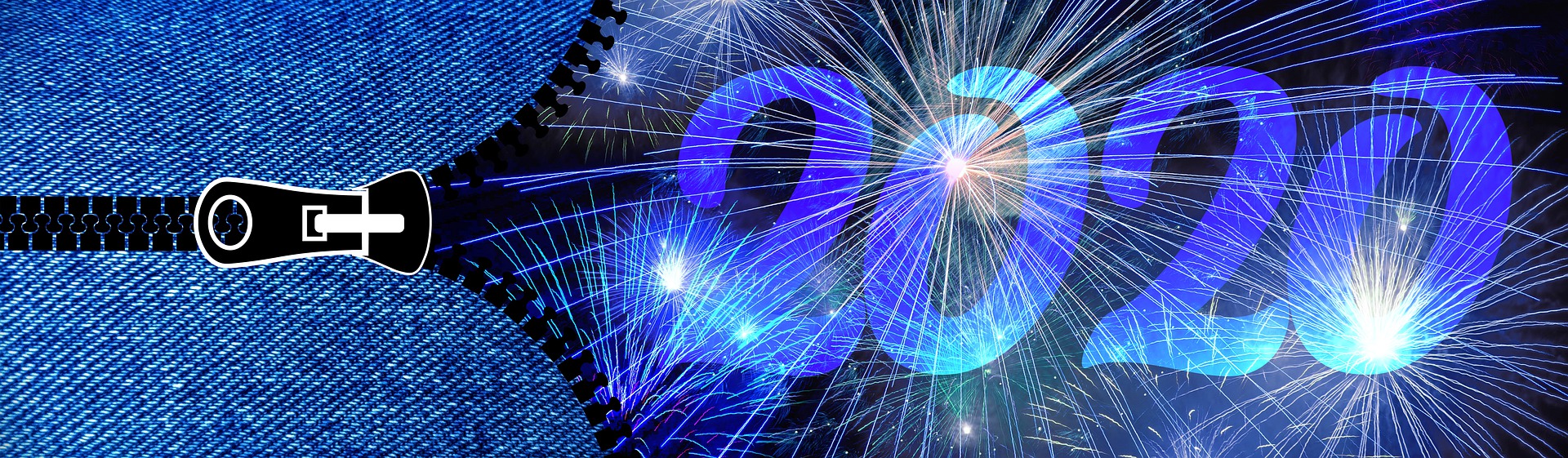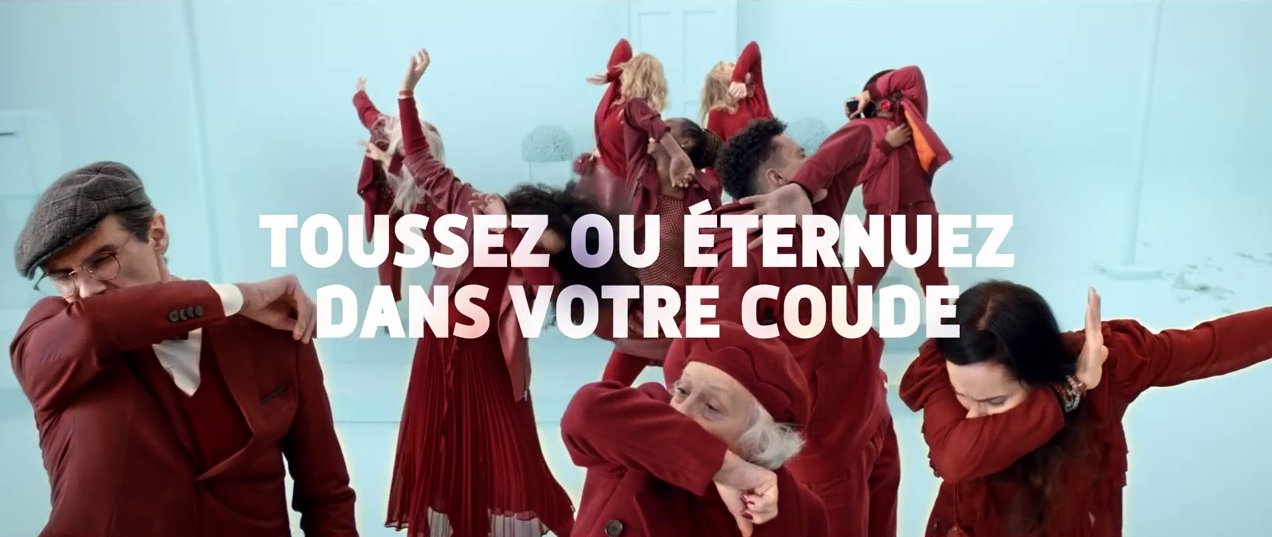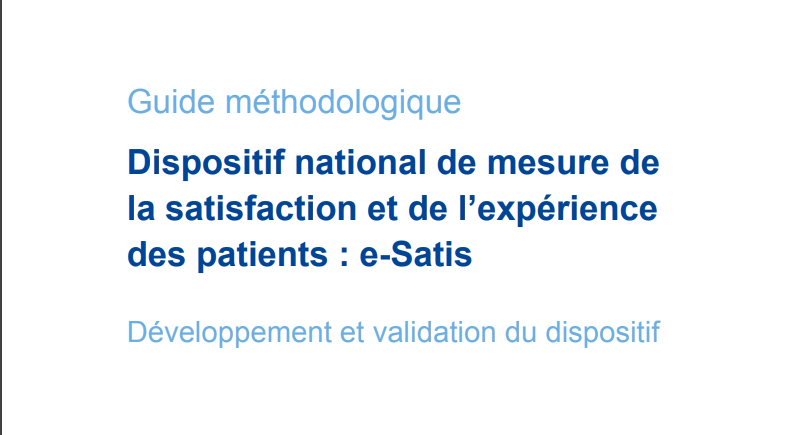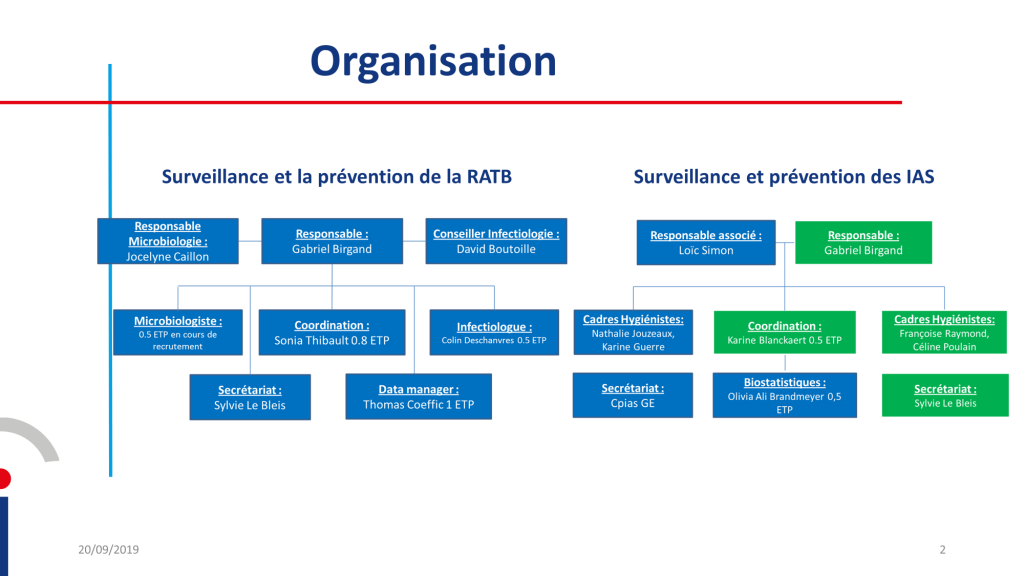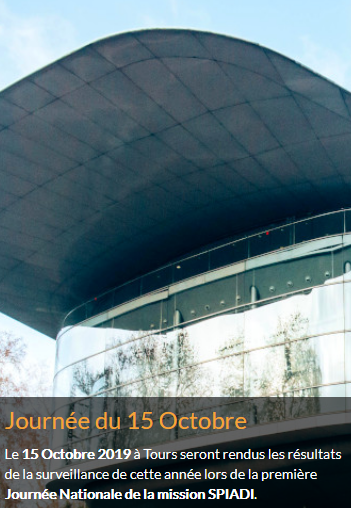Afin de vous aider à planifier vos activités 2020 nous vous proposons le calendrier annuel de planification de l’activité des 5 missions nationales de surveillance et de prévention des infections associées aux soins.
Vous y trouverez une lecture chronologique par activité (évaluation, surveillance ou autre) et une approche complémentaire par mission (MATIS, PRIMO ; SPARES, SPIAIDI et SPICMI).
Pour chaque projet vous avez à disposition l’adresse mail à contacter pour toute information complémentaire.