Dans le cadre de son volet prévention, la mission Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance dans les Etablissements de Santé (SPARES) a proposé Eva-GEX, une évaluation des items clés des pratiques de gestion des excreta en établissements de santé (ES) permettant d’obtenir un score de maîtrise du péril fécal par item d’intérêt pour orienter la mise en œuvre d’actions d’amélioration. Les résultats de cette enquête sont maintenant publiés. Vous pouvez les consulter ici.
Nous vous remercions de la participation à cette évaluation qui a été conséquente (2 130 unités de soins, 17 213 professionnels et 9 360 patients, dans 464 établissements de santé) et rend compte que quasiment une unité de soins sur 10 rapporte une épidémie d’origine digestive dans l’année passée. Ce qui souligne l’importance d’améliorer les pratiques de gestion des excreta sur le terrain.
Les résultats soulignent que les équipements de protection individuelle sont disponibles dans la grande majorité des unités, mais leur fréquence d’utilisation peut être améliorée, surtout pour la protection de la tenue professionnelle, et l’hygiène des mains. Les freins aux bonnes pratiques rapportés concernent principalement des insuffisances matérielles, principalement pour les dispositifs réutilisables. Eva-GEX rapporte que la mise en place d’une procédure locale de gestion des excreta, les actions de sensibilisation et d’évaluation des pratiques de gestion des excreta sont les mesures statistiquement corrélées à de meilleures pratiques professionnelles, notamment l’hygiène des mains, la protection de la tenue, la bonne utilisation du lave-bassin et l’arrêt de l’utilisation des douchettes.
Eva-Gex comportait aussi un questionnaire concernant les pratiques des patients après être allés aux toilettes. Si le lavage de mains des patients autonome est assez élevé, cette mesure simple d’hygiène n’est pas systématiquement proposée aux patients alités ne pouvant utiliser les toilettes de la chambre. Cela rappelle le rôle important des soignants dans l’éducation des patients à l’hygiène personnelle.
De façon intéressante, l’enquête d’impact proposée à la suite d’Eva-GEX a permis de mettre en évidence que l’audit Eva-GEx a été contributif à l’amélioration des pratiques et l’application en ligne restant disponible, cet outil peut s’inscrire dans la démarche d’amélioration continue des établissements de santé.






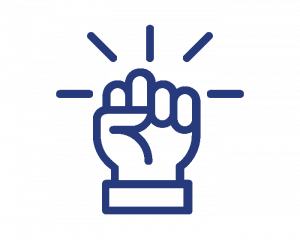

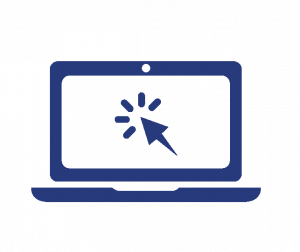

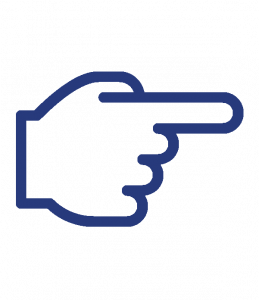 Le lien du DGS :
Le lien du DGS : 
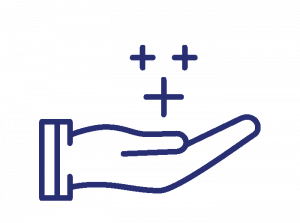 Un projet multidisciplinaire
Un projet multidisciplinaire